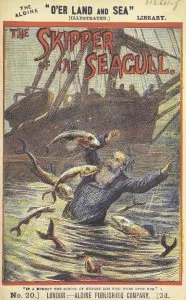César Baldaccini dit César, Compression « Ricard », 1962, Centre Pompidou, Paris
Il est peu d’occasions dans une vie de rencontrer une œuvre qui vous parle. Lorsque cela se produit surgit comme une urgence de saisir le moment puis un besoin pressant d’en tirer toutes les conclusions possibles, pour que l’œuvre compte intellectuellement autant qu’elle compte émotionnellement. Ayant très tôt été familiarisé avec l’œuvre de César Baldaccini (1921-1998) puisqu’il était, comme je le suis, originaire de Marseille, quelle ne fût pas ma stupeur lorsque je rencontrai pour la première fois, au Centre Pompidou de Paris, l’une de ses compressions. En effet, l’apprenti penseur que j’étais (et que je suis toujours) fût pour la première fois mis en face d’une œuvre qui donnait forme à sa conception du temps.
Se présente d’abord à nous le temps historique, qui n’est en fait qu’un long assemblage d’un temps mesuré découpé par le calendrier et l’horloge, agençant notre journée et commandant odieusement notre compréhension de la temporalité – la vie, du futur au passé. Sous cette double couche se trouve le temps social, agrégat de normes, tacites ou explicites, et de lieux communs déterminant les « moments » d’une vie – l’âge (temps mesuré) qui nous rend déjà vieux ou encore jeune, le bon moment pour le mariage, la parenté. Ces considérations sont souvent sous-tendues par la logique du temps biologique, horloge interne à la tête de nos corps – les mouvements hormonaux sont autant d’exemples. Enfin, au centre de cette cible, le temps personnel : cet inatteignable flux d’instincts et de pensées non articulées qui constituent l’essence de nos personnalités – cet irrésoluble problème d’un monde intérieur duquel il nous est impossible de témoigner, sinon dans la forme que prennent nos actions et idées. Ce temps personnel conditionne, entre autres, notre perception des temps précédemment mentionnés et l’importance qu’on leur y accorde. Bien que la notion soit quelque peu abstraite, elle se matérialise toujours quelque part dans le produit, dans ce qui de nous a émané : chez un artiste, son art.
La compression est ici dirigée, elle est faite d’éléments choisis et assemblés avant que la presse ne fasse son travail : n’étant pas question de compresser un objet simple et seul, le travail consiste à sélectionner des éléments disparates pour les disposer dans la zone de compression en ayant seulement pu imaginer le rendu final ; l’œuvre repose déjà sur la sélection des éléments à compresser, puis elle s’articule ensuite dans la force et la durée d’action de la presse. Pour « Ricard », César choisit de faire référence à un bout de son identité : Marseille (le Ricard étant une boisson alcoolisée originaire de la ville, où elle y est très populaire). Ce faisant, il lui envoie un amer baiser : Marseille est présente, mais écrasée. Cette décision consciente est un premier mot dit de la relation ambiguë que César entretient avec son identité, car parler de ses racines avec un écrasement tel, c’est à la fois les embrasser et les renier.
Le geste artistique se résume là au choix, il n’est plus question de technique et l’objet final n’est en rien maîtrisé dans sa totalité – l’artiste n’est alors qu’un décideur, et devient en quelque sorte étranger au produit fini. Ce tissage du choix et du hasard est rendu vivant par l’intermédiation de l’artiste dans la gestion du temps. En effet, seuls une seconde de plus ou un bar en moins changeraient le rendu final, duquel la main de l’artiste est retirée – sa présence repose sur l’aspect compositionnel, et non plus manufacturier.
Les caractéristiques formelles sont, elles aussi, ambigües : la simplification, l’abstraction des éléments métalliques de leur forme et fonction originelles font du tout une imbrication infinie et invisible de matière contenue dans une forme rectangulaire très rigoureuse, presque martiale. En résultent des tensions entre fond et forme, entre essence et expérience – un contenant géométrique, un contenu désordonné ; une ontologie fonctionnaliste, une perception dé-fonctionnalisée. C’est par ces problèmes si directement posés que le César perplexe s’exprime : les conflits proposés sont autant de réflexions sur la nature d’une identité, ici l’identité d’une chose – réside-t-elle dans l’essence de l’objet, ou ce que l’on en fait ? Que dois-je, en tant que spectateur, faire prévaloir : la fonction première de l’objet, ou celle dont il m’est donné de témoigner ? La profusion des couleurs, autre élément formel de l’œuvre, parle peut-être ici plus qu’ailleurs : l’identité est morcelée, composite et hétéroclite, donc difficilement dépliable.
L’ambiguïté de la relation que César entretient avec son œuvre est relayée par une critique à la fois profonde et superficielle de la société qu’elle entend commenter : César est un homme né simple, devenu mondain et populaire après quelques années passées à Paris, qu’il a rejoint enoctobre 1943 pour étudier aux Beaux-Arts. Établissant lui-même une sorte d’amour dépassionné, froid et calculé pour le public en disant « j’ai essayé d’aller vers le public pour que le public vienne à moi. », il m’apparaît comme logique de chercher dans cette œuvre le regard critique que César pose sur son environnement.
L’utilisation de la presse pour détruire des produits de la société de consommation apparaît déjà comme une critique de cette dernière, effectuée au moyen de l’innovation technologique qu’elle met à disposition de l’artiste – une critique de l’intérieur, que l’on pourrait par exemple rapprocher de la critique institutionnelle de Fred Wilson dans la mesure où l’élément critiqué est une partie essentielle et irrétrécissable de la critique. Ce point de vue est d’autant plus subtilement exprimé qu’il utilise en partie un produit phare de cette société, c’est-à-dire la voiture, symbole de l’émancipation achetée.
Cette société consumériste, se basant sur une quête du plus grand, du plus grand nombre, quelque part du trop, est ici commentée par son contre-pied : l’œuvre de César réduit, elle condense, rapetisse. Le chemin inverse qu’elle emprunte la fait nager contre le courant d’une société qui s’étend, idéologiquement comme géographiquement – notre compression se vêt ici d’une valeur résistante, émet comme un appel lancinant qui prend une double forme : la compression qui commente une surproduction d’objets en réduisant l’espace qu’ils prennent, et en les privant de leur fonction originelle.
Cette condensation comporte néanmoins des trous, pliures et creux qui donnent au tout un peu d’air ; cet espace négatif, tout de même minoritaire, fait respirer l’ensemble et lui donne presque un caractère anthropomorphique (étayé par l’espace que l’œuvre partage avec l’individu qui la regarde) humanisant l’ensemble tout en modulant la diatribe en affaiblissant son aspect monolithique – une critique qui apparait moins violente que celle que peut par exemple développer Jean Tinguely, lorsque son Hommage à New York(1960) prend un feu que l’œuvre allume d’elle-même.
La compression est aussi fortement caractérisée par son caractère innovant. Qualifiée de « stade nouveau du métal », la pratique n’eut de cesse de provoquer le « scandale » lorsqu’elle fut introduite pour la première fois, au Salon de Mai 1960 – on ira même jusqu’à la qualifier d’« attentat à la sculpture ». Elle se place ainsi en opposition directe avec l’histoire qui la précède, d’abord parce qu’elle n’est pas une fabrication de l’artiste mais plutôt une idéation, ensuite car elle est une sorte d’insulte à la société (comme si l’artiste disait « regardez comme je les maltraite, les commodités que vous chérissez tant ») – les distanciations du temps biologique comme social concourent à une remise en cause du temps historique.
Cette irrévérence, qui représente à mes yeux l’une des caractéristiques du génie, peut dans un certain sens être rapprochée de celle dont faisait preuve Marcel Duchamp lorsque, 43 ans plus tôt, il décidait de faire d’un urinoir une œuvre d’art – la radicalité de l’artiste est la cause première de l’opprobre dont il sera tout d’abord couvert, avant que sa vision n’en triomphe. C’est que son auteur n’a eu de cesse, au fil de sa longue carrière, de remettre en cause les canons sculpturaux. La compression n’est qu’une étape du chemin qui mènera César à l’agrandissement démesuré de son pouce, s’inscrivant à sa façon dans la tradition de l’autoportrait, en passant par l’expansion de polyuréthane, entre sculpture et happening (il en distribuait des morceaux à la foule venue voir l’expansion se former). Ce stade marque le premier pas qu’il fera pour s’écarter de la sculpture traditionnelle, à laquelle il reviendra tout de même quelques années plus tard, une fois sa révolution effectuée – car peut-on oublier son premier amour ?
Je pense donc que cette Compression « Ricard » est la cristallisation du temps personnel de César Baldaccini puisqu’elle articule les aspects d’une personnalité complexe et perplexe, qui embrasse ses origines sans jamais les renier mais les porte simultanément comme une espèce de poids, lui, l’homme de la Belle-de-Mai (quartier populaire marseillais) qui devint la coqueluche du gratin artistique parisien, l’homme simple qui vécut dans une société compliquée, pour qui les compressions n’avaient rien d’intellectuel mais qui n’aura de cesse de poser de nouveaux problèmes, toujours plus profonds et plus difficiles. Cette étude nous a permis, au-delà d’entrevoir les positions de l’artiste par rapport aux temps, de préciser notre compréhension de ces temps : loin de n’être que des temporalités, ils sont aussi des prises de position face à ces temporalités. Nous ne saurions apposer au temps la connotation que le temps historique lui a donné : le temps est beaucoup plus qu’une unité, qu’un morceau de temporalité, il est tout entier perception, rapport entre le monde intérieur – propre à chacun, représenté par la polarisation personnelle – et le monde extérieur – bien commun, représenté par l’extrapolation historique. Le but devient donc d’étendre son temps personnel, de manière à faire de tout ce qui nous entoure une chose perçue, interprétée, digérée, personnalisée. Étendre son temps, c’est faire du monde le sien. En cela, César a inondé, avec ses compressions, le temps historique de son temps personnel – il s’est versé dans l’histoire, a pourfendu les barrières qui contraignent l’expression des iconoclastes. Néanmoins, lorsqu’il disait, dans l’interview du 9 octobre 1966 accordée au Provençal-Dimanche, « C’est mon œuvre qui parle d’elle-même, et qui parle pour moi », il avait légèrement tort : l’œuvre ne parle pas, c’est à nous de la faire parler. En lui ayant donné un caractère qui m’est propre, j’ai accompli sa destinée : sur le champ de perception qu’elle m’a offert, j’ai semé.