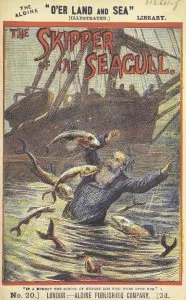Gustave Courbet, Les Casseurs de Pierre, 1849.
Le travail en art peut, à mon sens, être entendu de deux façons. Il peut désigner, dans sa forme la plus commune, la nature du labeur artistique, l’usage de la main de l’artiste à des fins productives. Il peut aussi être entendu comme la responsabilité qui repose sur ses épaules quant au langage formel à donner à l’œuvre – responsabilité dépendant grandement du mouvement auquel le peintre est apparenté ou, plus généralement, du message qu’il veut transmettre. À cette responsabilité du langage formel vient s’ajouter la paternité du « sens » d’une œuvre.
Comme pour tout travail, la tâche artistique vient avec la responsabilité de l’effectuer d’une certaine manière – il m’apparait, en étant bref, comme une volonté d’expression couplée à une responsabilité de sens.
Voyons comment, sous-tendant la révolution picturale opérée entre les XIXème et XXème siècles, un autre retournement, peut-être plus discret, prend place : la main de l’artiste se retire de l’œuvre qu’il enfante. La technique n’est plus et laisse place à l’idéation pure, le sens n’est plus dicté par l’artiste mais devient créé par le spectateur.
Il est encore grandement question de technique lorsque Gustave Courbet (1819 – 1877) est dans la fleur de l’âge. En 1849, ses Casseurs de Pierreà peine secs, le réalisme – apparu après la révolution française de 1848 – se propose de peindre le vrai. Le travail artistique du peintre réaliste repose alors sur sa capacité à traduire son époque le plus fidèlement possible. Sans l’artifice romantique et en marge des canons académiques, le peintre réaliste ne veut plus mentir. Il utilise pour cela son pinceau, débarrassé du symbolisme, pour dépeindre une réalité crue.
Le tableau de Courbet prend pour sujet des travailleurs tout entiers versés dans leur tâche, comme pour faire allusion à la cause de laquelle l’artiste se réclame : si ses sujets cassent de vraies pierres, lui veut casser la monolithique institution artistique pour dégager la vérité en peinture, enserrée par le roc académique. Sa responsabilité, il la porte encore au bout d’un pinceau qui dépeint les choses, qui dépeint un monde hautement visible : le sens est explicitement dicté par le peintre. La naissance de l’abstraction, si elle prétend également à une quête de la vérité, prend le chemin opposé.
Quelques 60 années plus tard, Kazimir Malevitch (1879 – 1935), encore aux prises avec les « détritus de l’Art Académique » dans lesquels il range presque toute la figuration (à l’exception des réalistes et impressionnistes), cherche la vérité par le sans-objet. Perpétuant la quête du peintre réaliste, il se donne pour responsabilité de peindre le monde comme il est, allant jusqu’à écrire, dans Du Cubisme et du Futurisme au Suprématisme. Le nouveau réalisme pictural, « En art on a besoin de Vérité et non de sincérité. » ; il choisit pour ce faire la forme pure, délivrée de sa prison figurative. Le modèle suprématiste qu’il propose est antinaturel au possible, et sur cela repose le travail de l’artiste comme il le conçoit : la créativité radicale, la création de formes et non leur reproduction. La responsabilité d’un artiste abstrait devient alors de penser la forme, de la créer. Il n’est plus, courant toujours derrière la vérité picturale, le fidèle traducteur de la réalité, mais bel et bien le créateur d’une réalité nouvelle.
Kazimir Malevitch, Carré Noir sur Fond Blanc, 1915.
Son chef-d’œuvre, Carré Noir sur Fond Blanc, est l’icône abstraite par excellence. On peut y voir à quel point le travail artistique a été bouleversé : s’il utilise toujours le pinceau, sa main est moins présente dans l’espace pictural ; l’œuvre, dépersonnalisée, est la représentation d’un monde méta-naturel – le rôle de l’artiste n’est plus de représenter la nature, mais il lui faut la renier pour accéder à la vérité. La culture, produit humain, gagne du terrain. Le spectateur, désarmé face à l’absence de références connues, doit alors projeter sa subjectivité dans le champ de perception qui lui est offert : le rapport de responsabilités quant au sens de l’œuvre tend vers un équilibre.
Le dernier bond notable dans l’évolution du travail artistique apparaît avec la montée des mouvements avant-gardistes des années 1960 : les Nouveaux Réalistes d’abord, les artistes conceptuels ensuite, vont radicalement se distancer du travail artistique tel qu’ils en ont hérité.
Le César (1921 – 1998) de 1962, réductionniste, prend le travail artistique à bras le corps. Ses compressions posent le problème de la parenté de l’œuvre : il n’est plus alors question de manufacturer un produit artistique, mais de le composer. Arrangeant les éléments à sa guise avant de les soumettre au travail de la presse hydraulique, la main de l’artiste s’est perdue dans le procédé ; seul son esprit demeure. Sa responsabilité devient donc de choisir, non plus de faire – il est un esprit libre qui va de rencontre esthétique en rencontre esthétique, ne pouvant que prévoir le résultat final duquel il devient en quelque sorte étranger. Devenu père spirituel de l’œuvre, son langage formel ne lui appartient plus : il se sépare du sens que l’œuvre contient. La sculpture, devenue mécaniquement assistée, est portée à un stade nouveau.
César Baldaccini dit César, Compression « Ricard », 1962.
Cet axiome de l’artiste choisissant plus que faisant est poussé à son paroxysme par les « proto-investigations » de Joseph Kosuth (né en 1945), dont One and Three Chairs est l’emblème. Ici, l’artiste est réduit à sa pensée. Il ne fabrique plus, ne touche plus à rien : son art est réduit à la matérialisation d’une idée. Plus qu’un changement radical de labeur, un transfert de responsabilité s’est opéré : le message n’est plus présenté par l’artiste, il est à construire par le spectateur, qui est laissé en face d’un puzzle cognitif qu’il a la responsabilité de reconstituer. L’artiste n’impose plus, il ne fait que proposer ; la tâche incombe au spectateur de bâtir, seul, le sens de l’œuvre qu’il regarde. Les éléments formels ne sont plus qu’une aide à la réflexion. L’inqualifiable œuvre de Kosuth se dédouane de toutes les balises esthétiques qui contraignent l’expression de l’artiste en se retournant sur elle-même : elle n’exprime plus rien de la personnalité ou de l’avis d’un artiste, mais n’est qu’un système. Le travail n’est plus dans la fabrication ni même la création, il devient un exercice d’idéation. Labeur et responsabilité artistiques s’en trouvent retournés.
Joseph Kosuth, One and Three Chairs, 1965
Les deux siècles précédant le nôtre ont vu le cours de l’histoire de l’art s’accélérer à une célérité inédite. Les valeurs autrefois chéries ont disparu. Il fût un temps durant lequel le travail artistique était presque synonyme d’artisanat. Obéissant à la volonté du patron, commanditaire qui décidait du sujet et d’un part de son traitement, l’artiste n’exprimait son talent que par la composition et la technique. Courbet, en se distançant de l’art académique pour chercher en peinture la représentation de son monde, a ouvert la voie à une contestation graphique sous-tendue par la réinvention du travail artistique. Cependant, il resta le créateur presque totalitaire du sens de l’œuvre, explicitement présenté, laissant peu de place à la subjectivité du spectateur.
L’avènement de l’abstraction, au zénith de l’art moderne, a fait de l’artiste un réinventeur du monde : pris entre pensée et action, il a révélé au spectateur un monde pictural fait de formes et de couleur présentées dans leur plus simple appareil. Il n’est plus alors question de représenter le monde actuel, mais de représenter le monde universel en séparant la personnalité de l’artiste du produit de son pinceau. Marchant dans les pas de l’iconoclaste Courbet, Malevitch continua d’opérer la réinvention du travail artistique par une dépersonnalisation de l’œuvre et un équilibrage entre artiste et spectateur quant au sens à donner à l’œuvre ; le champ de perception qu’il offre donne une importance accrue à l’interprétation du spectateur.
Continuant la séparation amorcée entre l’artiste et son œuvre, César fait de ses compressions des rencontres plus que des productions. Distant du produit fini, il est placé en amont, choisissant les éléments qui la composent sans être le maître de la composition. Se dédouanant de la responsabilité productive, il laisse au spectateur le poids d’interpréter une œuvre qu’il n’a fait qu’intuitivement imaginer.
Kosuth tirera toutes les conclusions de cette méta-production avec ses « proto-investigations » de 1965 (il n’a alors que 20 ans). L’œuvre est alors pure matérialisation de l’idée. Elle a fini d’être production, redéfinissant alors le travail de l’artiste comme le sens de l’art – suivant le chemin ouvert par Marcel Duchamp et ses readymades, l’art n’est plus la fabrication, mais devient l’idéation. Le spectateur a alors toute la responsabilité du sens ; c’est à lui de déplier l’œuvre, qui se présente comme recroquevillée devant ses yeux. C’est, lui aussi, par la pensée qu’il fait la fait vivre.
L’artiste est donc passé, en 120 ans, d’un peintre créant le sens d’une œuvre à un penseur proposant au spectateur de le faire. Son travail, auparavant intimement lié à la manufacture d’un tableau ou d’une sculpture, a pris le tour conceptuel de l’idéation. Cette distanciation a eu pour effet de placer la responsabilité du sens sur les épaules du spectateur.
Néanmoins, l’artiste se doit toujours de faire une chose : nous proposer sa vision de la vérité en art.