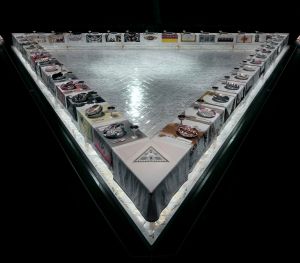Comment notre rapport historique au vêtement évolue-t-il lors de périodes d’incertitudes et de limitations physiques ? Dans une dimension individuelle, le vêtement personnifie la dignité dans plusieurs cas. Le vêtement répond aussi à un discours corporatif et collectif. Cependant, le vêtement comme outil d’activisme revendique-t-il suffisamment sa transparence, sa dépendance à sa consommation, à son environnement et à son exploitation humaine ? La crainte du renversement des pouvoirs et du déclin d’un système économique semble trop étouffante dans ce climat sociétal bouleversé par l’invisibilité. Celle-ci divise les nations malgré les élans de solidarité.
Vivre dans un monde globalisé, mais, à la fois, individualisé est empreint d’un instinct de survie. D’ailleurs, l’histoire de la mode a été influencée par les incertitudes de pérennité et de renouvellement historique, pendant les divers conflits mondiaux du vingtième siècle. Nécessairement, les conflits entre les états relèvent de paradigmes de nature économique, matérielle, environnementale et interculturelle. L’an 2020 ne s’éloigne guère de ce cycle guerrier, lequel a meurtri l’humain au sein d’un statut de conquérant prônant la puissance au profit de l’émancipation collective. Malgré les disparités des ressources territoriales et culturelles engendrées par la concentration des ressources en mains-d’œuvre, des voix prétentieuses poussent l’ignorance à un paroxysme discursif chez le citoyen du monde d’aujourd’hui. Un citoyen soupçonnant les uns et les autres, les autorités, la science, cherchant un bouc émissaire…
Toutefois, l’an 2020 ne se limite pas qu’à la crise sanitaire du Covid-19 pouvant être surnommée la guerre épidémiologique de notre ère. La coexistence entre les mœurs patriciennes et les privilèges octroyés par le détournement politique, économique, et de pratiques utilitaires font en sorte que le secteur vestimentaire soit réellement marginalisé dans une posture esthétique plutôt que collective et transformatrice. Le vêtement est similaire à un terreau fertile, car l’industrie textile employant des individus dans l’ombre témoigne d’une grande résilience. Pendant la crise de la Covid-19, nombreuses furent les entreprises ayant impayé des collections planifiées des mois et des années à l’avance afin de séduire constamment les consommateurs et les fashionistas assoiffés de nouveautés. Au détriment du style personnel d’un individu, l’industrie de la mode a contribué au discours de l’idéalisation de la nouveauté lorsqu’en réalité les matières premières ainsi que la confection d’un vêtement sont issues d’un cycle environnemental et médiatique, mais également de divers milieux culturels et de populations discriminées par les ambassadeurs de marques. Le blogue de la plateforme Fashion Revolution intervient régulièrement dans la lutte aux préconceptions de l’industrie de la mode éphémère. Récemment, avec les protestations contre la violence et les mouvements pour les droits et équités des personnes issues des communautés africaines, il n’est guère anodin que ces contestations de brutalité et de répressions systématiques surviennent à ce moment précis de l’histoire collective. En effet, la crise du Covid-19 a amplifié, a fait ressurgir les inégalités dont sont victimes les plus vulnérables au-delà des privilèges individuels des personnes en position d’autorité se croyant indemnisés.
Suivant le phénomène d’isolation sociale, le phénomène de bien-être individuel semble dissimuler une problématique plus grande de distanciation créative et de dichotomie hiérarchique dans le secteur du vêtement. Au profit de son industrialisation à grande échelle, d’appropriation culturelle des savoir-faire des périodes coloniales, l’exploitation des champs de coton et de la main-d’œuvre dans des pays aux infrastructures apparemment inférieures, ce sont les regards extérieurs et la migration des civilisations Euro-Américains qui ont érigé le concept de « races » et d’exploitation. La crise de la Covid-19 semble exacerber l’effondrement d’un système cyclique. L’industrie du vêtement est au cœur de ce débat, car elle cimente le partenariat entre les mouvements migratoires, le principe d’échanges et de mutualisme qui se fonde excessivement sur des accords bureaucratiques au lieu de rapports humains et environnementaux. Les conditions fortuites ne profitent délibérément qu’aux entrepreneurs de conglomérats appropriant la connaissance d’autrui.
En effet, ce phénomène d’appropriation remonte à la Première Guerre mondiale au moment où les échanges se sont intensifiés entre les pays pour produire des armements, mettre à profit le travail des femmes, ou encore accentuer et répliquer des modèles d’affaires pour le bien d’une communauté au détriment d’une autre, essentiellement en prisant un rapport capitaliste. Des empires coloniaux du début du dix-huitième siècle à l’entreprise de l’esclavagisme de tous les domaines connexes, il n’en est pas moins que le secteur du vêtement a soutenu le pilier des artifices des apparences. Des apparences ont dérouté lors de la Covid-19 en remontant au profilage des industries indépendantes au savoir-faire importé résultant du processus d’acculturations de diverses nations. En minant la crédibilité des communautés mondiales, le rapport des importations, exportations et des délocalisations a sans doute étendu la capacité de production et de ressources.
Cependant, ce rapport à la production en série a enrayé l’intelligence individuelle et artistique ou collective propre à une communauté en favorisant la nécessité de production, de distribution et de revente. Pourquoi la crise sanitaire actuelle fait-elle ressurgir les disparités et les conflits d’intérêts construits au cours des derniers siècles ? J’estime que la montée de la notion d’utilitarisme a marqué les pensées afin de valoriser un instinct de survie pour les infrastructures bureaucratiques et collectives.
Effectivement, paraître heureux, paraître en bonne santé, paraître, paraître, paraître… ne suffit plus. Le paraître se transforme en devenir afin de célébrer l’expertise et le sentiment de dépendance engendré par des siècles de conquête de l’humain souhaitant assouvir ses ambitions de puissance. La richesse qu’autrefois apportait l’orientalisme créé par l’invasion et l’appropriation est devenue signe de faiblesse et de jugement. Retrouver un sens d’autonomie séparé de l’orientalisme d’une nation et de sa richesse interne deviendra-t-il la norme ? Je crois en une approche activiste d’un style hybride, empruntant les codes de la fluidité des genres masculins, féminins créés par des communautés aux voix marginalisées. Ainsi, les individus ne pouvant pas crier leurs incertitudes pourront mettre celles-ci en évidence avec des textiles et des coupes soulignant les injustices, ou encore avec des connotations illustrant les ravages de l’appropriation sans toutefois devenir une cible commerciale.
L’incertitude individuelle et étatique suprématiste s’avère trop prenante dans ces périodes de crise. Un vêtement apporte un certain sentiment de sécurité face à la violence pouvant devenir problématique en soi. Cette sécurité vestimentaire ternit l’image des communautés culturelles discriminées en entretenant une industrie normative du vêtement approuvant son système historique. Récemment, le Vogue Magazine a publié un article sur la façon dont les grandes compagnies usent des voix africaines et redistribuent leurs profits sous forme de campagnes publicitaires de sensibilisation au profilage racial. Ces gestes sont appréciables, dans une certaine mesure, mais exigent une réflexion sur les voix créatrices des grandes marques. Ces réflexions sont vastes et au-delà de mon bref écrit, car elles témoignent de la nécessité d’enraciner les marques de vêtements dans des créneaux d’accessibilité sociale reflétant tous les groupes sociaux, dont ceux bafoués dans le processus de fabrication et d’appropriation culturelle d’un vêtement. Exiger la transparence et faire en sorte que chaque marque maintienne sa production localement relève d’une transition parfois éthiquement controversée.
D’un certain point de vue, le contexte mondialisé favorise l’effervescence de la chaîne d’embauche, de production et d’approvisionnement mondiaux, mais contribue également à la stigmatisation des profils individuels et hiérarchisés. Je m’interroge ainsi sur la viabilité des raisonnements transitifs favorisant l’activisme médiatique aux actions concrètes que le vêtement peut engendrer. À quand l’éducation systémique, à la diversité locale, et à l’aspect non promotionnel ou abusif de l’interdépendance qui unit les communautés mondiales depuis des siècles par le vêtement ?