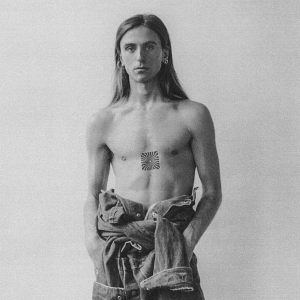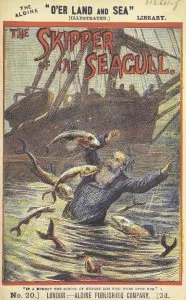Il a fallu du temps pour reconnaître certaines femmes de lettres (Mme de Sévigné, George Sand, Jane Austen…) comme des auteurs majeurs de l’histoire littéraire. C’est que pendant longtemps, le pouvoir de décision a appartenu quasi exclusivement à des hommes. Pouvoir institutionnel (qu’est-ce qui est enseigné comme la « vraie » littérature ?) mais aussi pouvoir de la critique littéraire. Or la majorité masculine des critiques littéraires a, pendant très longtemps, mis de côté les femmes de lettres, au talent pourtant loin d’être inférieur à celui de nombreux écrivains masculins. Il y a eu bien sûr des exceptions ; mais aujourd’hui encore, de nombreuses écrivaines sont négligées, laissées de côté, sous-considérées. Louise Labé fut de celles-là. Elle émerge pourtant, de plus en plus, comme une figure essentielle de l’histoire de la littérature française et francophone. Le pouvoir de la critique semble finalement l’avoir reconnue comme un « auteur » important ; si elle reste peu abordée dans les lycées, l’académisme universitaire s’accorde sur son rôle fondateur. C’est que cette poétesse du 16e siècle s’inscrit de façon fort originale dans la mémoire littéraire.
On peut considérer Louise Labé comme une des premières femmes de lettres modernes. Françoise Charpentier, dans la préface des Œuvres poétiques de Labé, qualifie celles-ci de « premier manifeste féminin en littérature ». Comment le comprendre ? On ne peut pas ne pas rapporter la poésie de Louise Labé au contexte dans lequel elle écrit. C’est cela qui nous permettra de comprendre comment une femme de lettres parvient à s’affranchir de la mainmise, quasi-exclusive, des hommes sur la littérature. Comment Louise Labé, face à la domination littéraire masculine, réussit-elle à développer une parole alternative ? Comment réussit-elle à créer elle-même son propre pouvoir poétique, qui contrecarre celui de la littérature de son temps ?
Imaginez-vous : nous sommes au 16e siècle. Le monde littéraire francophone est en pleine reconstruction, en pleine renaissance. Nous changeons d’ère : les poètes de la Pléiade, Joachim du Bellay et Pierre de Ronsard en tête, cherchent à renouveler la poésie française, en affirmant l’égale dignité de la langue française avec le latin ou le grec ; François de Malherbe, poète de la cour, cherche à ancrer le pouvoir royal dans une poésie qui annonce le classicisme ; bientôt, Boileau écrira son Art poétique pour fixer définitivement les règles officielles de la poésie. Dans cette ambiance de définitions rigoureuses de ce qui est attendu en littérature, un petit groupe de poètes se forme, près de Lyon, sans professer une idéologie à part entière, mais sans être seulement un amas de singularités : « L’Ecole lyonnaise ». Avec d’autres, dont le chef de file Maurice Scève, on retrouve dans ce groupe Louise Labé.
Au sein même de l’Ecole lyonnaise, Labé a porté une voix dissonante : face à l’hermétisme de la poésie de Scève, qui utilise sans cesse les ambiguïtés, les ellipses, qui cherche à noyer notre compréhension dans le lac de l’érudition, Louise Labé propose un style beaucoup plus simple. Face au mystère des poèmes de Scève, elle prétend à une poésie souple et accessible. Mais simple n’est pas simpliste ; souple n’est pas laxiste. Que son style soit clair n’empêche pas que ce dont elle parle n’a rien d’évident. Le poème « Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie » met en scène une femme amoureuse. Quel en est l’intérêt ? Cela montre déjà qu’une époque de domination masculine n’exclut pas qu’une voix féminine puisse nous toucher. Ensuite, Labé joue en cela sur les représentations sociales de son époque : on croyait les femmes facilement émues, la voilà qui présente une femme amoureuse dans l’inconstance émotive. Est-ce que cela veut dire que Labé adhère à l’idée que la femme est « par nature » inconstante émotivement ? Loin de là. Car quel que soit notre genre, ce qu’elle dit peut nous émouvoir. Ce poème parle d’une femme amoureuse ; mais il ne parle pas qu’aux femmes amoureuses. Il s’adresse à tout le monde, parce que chacun peut se reconnaître en lui.
Nous avons bien affaire à un « manifeste féminin en littérature » : ce n’est plus à un homme mais à une femme (à un personnage féminin) que le lecteur doit s’identifier. C’est important : si les livres forment en partie la culture d’une société, ils affectent nécessairement les représentations sociales ; que des livres aient pour personnages principaux uniquement des hommes, il va de soi qu’il y aura une tendance de tous à accentuer le rôle des hommes dans les décisions politiques – dans le pouvoir social. A l’inverse, montrer une alternative – un personnage féminin en littérature auquel on peut s’identifier – c’est combattre des représentations sociales figées et c’est amorcer une nouvelle littérature.
Plus encore, en tant que femme, Louise Labé est à même de parler de ce que les hommes du 16e siècle ne pouvaient évoquer : les contradictions inhérentes à tout être humain. Dans leur recherche d’unité (de la langue française, de la poésie…), Du Bellay, Ronsard ou Malherbe ont laissé de côté le déchirement intérieur que tout un chacun peut pourtant éprouver. Or dans les poèmes de Louise Labé, ce qui apparaît massivement, c’est la contradiction. Ce qui fait que Labé peut encore nous toucher aujourd’hui, exercer un pouvoir sur nous. Il nous arrive souvent de désirer quelque chose, et en même temps de savoir qu’il n’est pas bon de le désirer. Mais quand il advient que notre désir et notre volonté (ce qu’on cherche et ce qu’on sait qu’il est bon de chercher) sont accordés, ça ne veut pas dire que nous sommes « unis » pour autant. Au contraire, nous pouvons vivre très contradictoirement une telle expérience. Dans Les grandes doctrines morales, Hubert Grenier expliquait que selon Foucault, « le plus grave n’est pas de vivre des situations contradictoires, […] mais de vivre contradictoirement des situations ». C’est de cela dont nous parle Louise Labé.
L’amour est ce qui déchire le sujet, ce qui le fait le plus vivre, et ce qui le rapproche le plus de la mort. Une fois qu’on a saisi cela, les mots de Louise Labé apparaissent comme un baume : comme l’expression de ce que nous pouvons vivre, que nous craignons de vivre. En donnant une forme poétique à nos sentiments parfois douloureux, elle nous permet de nous apaiser et de comprendre que vivre contradictoirement l’amour est le lot de l’amour – loin d’être une tragédie, être amoureux est un poème – loin d’être une comédie, être amoureux est un paroxysme vital.
Louise Labé a peu écrit : nous n’avons d’elle qu’à peu près 700 vers. Et pourtant, ses poèmes nous interpellent, et interpellent nos modes de vie contemporains. Les libertés démocratiques ont démultiplié l’éventail des possibilités de vie. Dès lors il va de soi que le premier écueil auquel tout un chacun se heurte est celui du choix. Que faire ? Vers où vais-je diriger ma vie ? Et précisément, du fait du grand nombre des possibilités ouvertes, cet écueil du choix est tout à la fois un écueil de l’hésitation. Et c’est là que Labé est apte à toucher notre monde intérieur, nos problèmes contemporains, notre vie la plus actuelle. Dans le poème « Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie », Labé aime à user de l’antithèse. Or que signale cette figure de style, sinon l’hésitation ? Le balancement ? Le vacillement des certitudes devant l’urgence vitale non prévue - ici le désir amoureux ? Découvrir cette poésie de l’indécision, c’est nous confronter à ce qu’on vit en permanence sans être capable de nous l’expliciter à nous-mêmes.
Face au pouvoir masculin littéraire du 16e siècle, Louise Labé s’est érigée, silencieusement, en voix alternative. En faisant d’une femme le narrateur de ses poèmes, en faisant de la figure du « poète » une figure féminine, elle ouvre la voie à une nouvelle façon de lire la poésie : non plus seulement en s’identifiant à des hommes, mais aussi à des femmes – c’est-à-dire, au 16e siècle, à tout un ensemble d’êtres marginalisés dans la société. En tant que femme, Labé aborde également des thèmes qui ne pouvaient, qui ne savaient pas être abordés par les poètes masculins de son époque. Faisant mine de prendre à sa charge la façon dont on voyait les femmes, des « inconstantes émotives », elle fait de l’inconstance émotive le cœur même de l’humanité. Renversant les représentations sociales, elle renverse par là, au moins dans l’esprit de ses lecteurs, la tyrannie du pouvoir du classicisme masculin. Nul doute que la première femme de lettres de l’histoire a encore beaucoup à nous apprendre sur la façon de subvertir les représentations sociales pour mieux conduire notre existence.
Image: Le Jardin d’Amour, Rubens