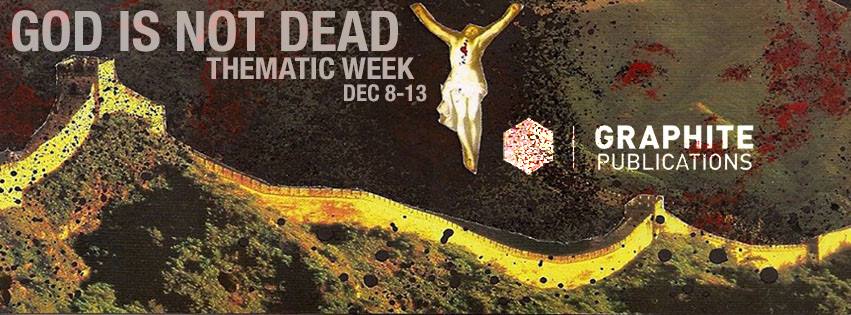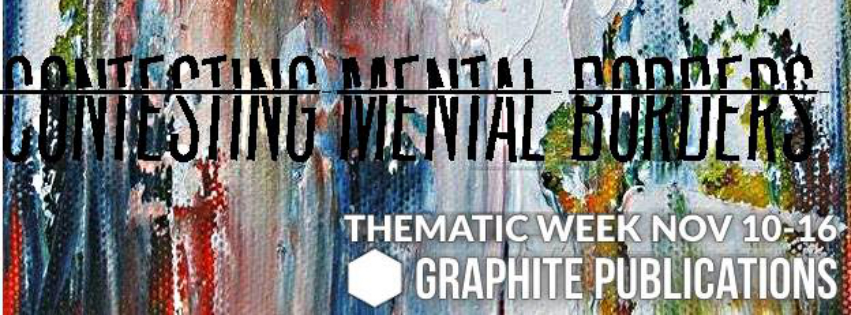Après avoir posé des questions sur la légalité de l’art urbain aux artistes de MURAL (lisez les entrevues avec les muralistes Eric Clement et Earth Crusher ici et celles de Mc Baldassari et Astro ici), j’étais curieuse d’entendre le point de vue sur la question des personnes dans les coulisses de cette édition amplifiée du festival. Je voulais également en connaître plus sur l’organisation et la vision qui inspire l’évènement, ainsi que ses liens potentiels avec les autres festivals montréalais. Pour répondre à ces interrogations, je me suis assise avec Pierre-Alain Benoît, directeur des relations publiques et des partenariats qui s’est occupé des communications pour diverses organisations, dont LNDMRK, agence de production artistique qui a contribué à MURAL.
Qu’est-ce qui t’a amené à être dans l’organisation de cette édition du festival MURAL?
Je suis impliqué dans MURAL depuis la première édition. Je connaissais déjà un peu deux des organisateurs, mais je travaillais à contrat pour la Société de développement du Boulevard St-Laurent dans les relations publiques. J’ai commencé au printemps 2013, au même moment où le festival se préparait. Donc ils m’ont demandé de m’intégrer à l’équipe du festival. C’était quand même un gros défi, au départ, de faire connaître un évènement à partir de rien. Il y a aussi le défi de communications autour du fait que c’est du street art, les gens ont des perceptions, des préjugés par rapport à ça. Peut-être moins maintenant, mais plus avant que le festival existe. C’est quoi la différence entre le vandalisme, le graffiti et le street art? […] J’aimais beaucoup le défi de travailler sur un projet comme ça.
J’imagine que son ampleur particulière cette année - il s’est déroulé sur onze jours plutôt que quatre – en fait d’autant plus un défi considérable.
Oui, c’est immense même comme challenge. Mais c’est une évolution naturelle aussi, parce que la production des murales comme telles a peut-être été la chose la moins difficile à adapter: ça prenait déjà plus de quatre jours à la plupart des artistes pour créer leurs œuvres, donc il y avait un planning qui était déjà préparé sur plus de quatre jours. C’est plus au niveau programmation, communications et production technique; là, c’est plus difficile de prendre quatre jours pour les transformer en onze, sans qu’il y ait de journées vides et en ayant le budget et les employés pour le faire, ça a été le plus gros défi.
Ça se prépare combien de temps à l’avance?
Je dirais que le festival prend à peu près 70% de mon année. Comme je suis en charge des partenariats publiques, je m’occupe de toutes les demandes de subvention, de partenariat avec la ville, le gouvernement du Québec, la Société des transports de Montréal, etc. Quelqu’un d’autre dans l’équipe s’occupe plus souvent des partenariats privés. Mais je donne souvent un coup de main, car j’ai une certaine expertise en gestion de projet. À l’année, on est une équipe de six-huit personnes et quand on arrive à trois-quatre mois du festival, on engage des stagiaires et des chargés de projets. Au moment du festival, on a une centaine de bénévoles qui s’ajoutent, plus une équipe technique engagée juste pour les installations. Donc, durant l’année, c’est une très petite équipe et tout le monde doit donner du sien […]. Les relations de presse et les relations avec les médias, c’est juste un élément du travail qu’il y a à faire.
Au niveau du financement, est-ce qu’il s’agit autant du public que du privé? Quels types d’organismes vous financent en général? S’agit-il d’un financement vraiment hétérogène?
Oui, quand même. Les deux plus gros partenaires financiers sont la Société de développement du Boulevard St-Laurent et la Ville de Montréal. Les deux ensembles doivent amener environ 40% du budget. Après, les autres partenaires c’est environ un autre 40% et le dernier 20% c’est des revenus autonomes qu’on fait, donc vente de billets, vente d’alcool, de chandails, etc.
Si tu nous parles de ton parcours, viens-tu du milieu des arts visuels, de l’évènementiel, des relations publiques ou es-tu issu d’un domaine plus inattendu?
Haha, c’est très insoupçonné! En fait, j’ai étudié en philosophie et je me suis lancé dans le mouvement étudiant en 2002. J’étais président de la Fédération étudiante à l’Université de Montréal à temps plein et j’ai travaillé à la Fédération étudiante universitaire du Québec dans les années 2004-2005, au niveau des prêts et bourses, grèves, etc. Ça m’a vraiment donné la piqure de la communication avec le public, des relations et des affaires publiques. J’ai fait ça dans différents domaines, mais voilà quatre ou cinq ans que je me suis lancé en affaires avec un collègue. J’avais vraiment le goût de travailler dans le domaine culturel, même si je ne suis pas du tout un artiste! Donc MURAL a été comme une révélation pour moi, un projet d’envergure dans lequel je pouvais me lancer.
Y a-t-il selon toi une similitude qui regrouperait le domaine des arts visuels ou du street art à Montréal par rapport à d’autres villes?
En général, dans toutes les grandes villes du monde, il y a vraiment en ce moment une explosion du street art, de l’art public, du muralisme. Avant, l’art public était considéré comme étant limité aux sculptures, aux monuments installés dans l’espace public. Parallèlement, le milieu du graffiti et du street art a connu une évolution. Au début, c’était très underground et marginal. À New-York, c’était des jeunes qui faisaient du lettrage sur des métros et c’était complètement illégal, alors qu’aujourd’hui, il y a beaucoup d’artistes qui viennent des Beaux-Arts (…) Donc je dirais que cette explosion artistique là dans le domaine permet de donner un souffle nouveau à ce milieu. Aujourd’hui, c’est plus juste considéré comme un trip culturel ou artistique, c’est de plus en plus considéré comme un outil de revitalisation urbaine. Autant pour les architectes, que les urbanistes, les politiciens ou les citoyens, qui aiment bien mieux avoir de beaux murs embellis, qu’avoir des murs gris, bruns ou de la brique nue.
Mais une particularité de Montréal comme telle? Je te dirais que par rapport à beaucoup d’autres, le festival MURAL a premièrement pour particularité que c’est fait avec une fermeture de rue donc ça permet vraiment au public de voir les artistes en direct […].
L’autre élément est l’organisation. Il y a beaucoup de villes, comme par exemple Miami, un des modèles dont on s’est beaucoup inspirés, où il y a une grosse sélection, beaucoup de murs, des projets organisés et d’autres pas. Il y a des artistes qui débarquent là et ils se trouvent un mur, une fois qu’ils sont là. Nous, on est vraiment dans l’organisation, on fait venir les artistes, on leur donne un mur, on leur paie l’hébergement, le transport, le matériel; on les encadre beaucoup. Ça c’est assez différent. Y’a pas beaucoup de villes dans le monde qui font ça.
Tu as parlé d’organisation. Ce printemps et cet été, il y avait Chromatic, Fringe, MUTEK, etc. Est-ce tu dirais qu’il y a une certaine convergence entre les différents évènements culturels?
Je pense qu’il y au une convergence dans le modèle, dans la manière où on fait les choses à Montréal. Montréal, à la base, c’est une ville de festival, même quand il y avait juste le Jazz, les Francos et les Nuits d’Afrique. Aujourd’hui, il y en a de plein de différents domaines. C’est que notre manière de vivre la culture est très évènementielle, très festive, très axée sur le divertissement aussi. Je pense que c’est ce qui fait la signature de Montréal.
Donc, quand il y a des nouveaux trucs qui apparaissent, comme le Piknic Electronik, Chromatic, MUTEK ou MURAL, même si c’est des formes d’art ou d’expression culturelles différentes, ça se construit sur un modèle semblable à ceux qui existaient avant. À Montréal, il y a une énorme tradition de gratuité de l’offre culturelle. Osheaga, c’est plutôt l’exception par rapport à d’autres. Ce n’est pas la Ville qui produit des évènements, la Ville accueille les évènements, fournit un espace en te laissant utiliser le domaine public. Mais toi, comme producteur d’évènement, tu dois avoir au moins une majorité de ton offre qui est gratuite en échange, c’est ça le modèle à Montréal. Ce qui veut dire qu’il faut que t’aies des subventions, des commandites. Tu peux pas faire tout ton revenu sur les ventes de billets, ça fait partie de la tradition […].
Est-ce que tu penses que ce type d’évènement artistique légal et encadré peut cohabiter avec le street art plus traditionnel et en marge? Crois-tu que les deux sont nécessaires?
C’est clair que les deux sont nécessaires. Dans le street art en ce moment, Il y a autant une présence des artistes qui viennent du graffiti et du tag, que d’artistes qui viennent des Beaux-Arts. Nous, notre objectif c’est que peu importe le fait qu’on encadre ou non les artistes, on veut avoir une diversité dans le style. La richesse de la création vient des deux côtés, y’a même de plus en plus de crossovers. C’est sûr que y’a toujours des gens qui vont préférer créer illégalement, spontanément. Je pense que cette dynamique doit continuer d’exister, mais, en même temps, si on veut vraiment transformer le paysage de notre ville avec un certain volume et une certaine qualité de création, on doit aussi s’organiser un peu et on ne peut pas laisser ça à la spontanéité. Les deux côtés doivent coexister et, 99% du temps, ils le font bien. Tu ne peux pas t’approprier autant l’espace publique si tu le fais juste illégalement, spontanément. Pareil si tu le fais juste légalement, de manière organisée.
Pour toi, l’évènement peut-il être l’occasion de démocratiser l’art auprès des personnes de la ville qui sont moins familières avec le domaine?
Clairement. On parlait des deux tendances: la tendance plus Beaux-Arts et la tendance plus graffiti. Dans les deux cas, ça permet de démocratiser ces formes d’art. Parce que, pour les artistes qui exposent, qui va dans les galeries, dans les musées? Ce sont les vrais fans de ces domaines, pas le grand public, à part une couple d’expositions au Musée des Beaux-Arts. […] Nous ce qu’on fait, c’est qu’autant les gens peuvent apprécier les trucs dans une ruelle et faits spontanément, autant ici, il y aura une carte, une signalétique sur la rue qui vont leur montrer où c’est, de l’Instagram, des réseaux sociaux, une structure de communication qui va permettre au public d’apprécier l’art. Ça le démocratise vraiment, parce qu’il s’agit d’endroits où les gens passent tous les jours.
Pour gérer ce genre d’évènements, qu’est-ce qui serait plus important? L’amour des arts ou le fait d’aimer travailler auprès du public, d’avoir une certaine vision?
Tout est une question de contenu. De plus en plus, avec les médias sociaux et l’interactivité des médias et des citoyens, tu ne peux pas réussir à promouvoir un évènement culturel si le contenu n’est pas jugé intéressant par les gens. Quand tu sais que c’est des œuvres d’art flamboyantes et qui attirent l’attention, c’est relativement facile de réussir à les promouvoir. Il faut juste que t’aies l’audace de ne pas penser que parce que t’es petit, les gens ne vont pas parler de toi. C’est comme ça que tu grandis. Si tu n’es pas audacieux, alors les gens n’entendront pas parler de toi. Mais quand tu sais que tu as un contenu aussi riche à promouvoir, c’est plus facile […]. Il faut juste y croire et oser […]. Il s’agit aussi de rester connecté avec les médias plus underground, les petits bloggeurs, tout en innovant, en allant chercher ceux qui sont un peu plus mainstream.
Lisez, dans le prochain et dernier volet de ce dossier, mon entrevue avec Zola, une artiste visuelle qui a participé aux collectifs Decolonize Street Art et Off Murales. Pour notre album des photos de MURAL, c’est ici.
Écrit par Alexandra Bahary.