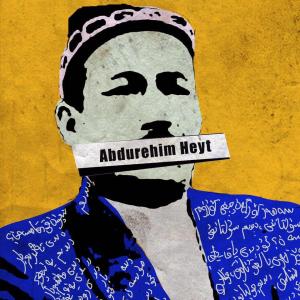Une candidate fraîchement nominée pour les élections européennes a été désinvestie après que des internautes aient exhumé de vieux tweets aux relents racistes que l’intéressée venait d’effacer. Cette histoire nous donne l’occasion de nous pencher sur Twitter, ses codes et ses interactions avec le monde réel, toujours plus nombreuses.
Source: https://blogs.spectator.co.uk/2016/02/twitters-new-safety-council-makes-a-mockery-of-free-speech/
Emmanuelle Gave, avocate de métier et membre d’une influente famille originaire du sud-ouest de la France, avait été propulsée en position éligible sur la liste européenne de Debout La France (DLF), parti de Nicolas Dupont Aignan, allié de Marine le Pen lors du deuxième tour de la présidentielle. Son père, Charles Gave, riche financier et adepte de la théorie du « grand remplacement», avait consenti à contribuer à la campagne du parti pour les élections européennes à hauteur de 2 millions d’euros.
C’était sans compter sur la vigilance des internautes. Un compte du nom de « Fallait pas supprimer », ayant pour spécialité de mettre en avant les tweets supprimés par les personnalités, dévoile rapidement une série de tweets d’Emmanuelle Gave dans lesquels l’intéressée réagit à chaud par rapport à divers événements des dernières années. Selon « Fallait pas supprimer », plus de 10 000 anciens tweets auraient été effacés dans la nuit du 18 au 19 février, après que la rumeur d’une candidature de Mme Gave soit ébruitée. Certains de ces tweets au langage très cru sont rapidement taxés de racisme par les internautes. Mme Gave contre-attaque par voie de tweet en brandissant la menace de poursuites judiciaires, s’appuyant sur des bases légales visiblement peu appropriées au contexte du réseau social. L’avocate invoque ainsi la protection de ses données personnelles afin de faire supprimer lesdites captures de ses tweets effacés, argument vite démonté par les internautes.
L’Effet Streisand
Cette histoire est un exemple type d’Effet Streisand: ici, la suppression des tweets se retourne contre Mme Gave en causant l’effet inverse d’attirer la lumière sur ses anciennes déclarations. Les médias se saisissent ensuite de la polémique, et l’émission Quotidien découvre même d’autres déclarations problématiques en fouillant le profil de Mme Gave, sur Facebook cette fois-ci. On apprend également que c’est une agence de communication – soit disant – spécialisée qui s’est occupé de faire le ménage sur le profil de madame Gave. Nicolas Dupont Aignan, qui avait d’abord tenté de défendre sa candidate, est finalement forcé de la débarquer manu-militari. Mme Cave change alors à nouveau de ton, toujours via Twitter, critiquant frontalement le parti qu’elle défendait encore quelques heures plus tôt, parti qu’elle avait de grandes chances de représenter au parlement européen.
Une arène ouverte à tous
Sans même s’intéresser en détail au contenu des tweets, cette rocambolesque affaire de désinvestiture express est riche en enseignements sur le fonctionnement de Twitter et son utilisation à des fins de communication politique.
Fort de plus de 10 millions d’utilisateurs français, Twitter est devenu un véritable microcosme. Politiciens, journalistes, artistes, activistes y côtoient les plus parfaits anonymes, interagissant selon des codes implicites et subtils.
Des polémiques s’y créent et s’y défont en l’espace de quelques jours, occasionnant des déferlements de haine sans pareils. La valse médiatique, existant depuis longtemps, y voit son intensité décuplée, les garde-fous habituels ne s’appliquant que rarement.
Paradoxalement, tout s’arrête souvent à la déconnexion, et l’on a beau s’être fait insulter par des milliers de personnes, il reste peu probable que quiconque vous dise quoi que ce soit si vous traversiez la rue pour acheter un croissant. Néanmoins, un nombre croissant de polémiques nées sur le réseau commencent à impacter le monde médiatique et politique.
Ces débats et « clashs » par écrans interposés entre anonymes existent depuis le début d’internet et des forums. La particularité de Twitter est de réunir sur la même plateforme une population bien plus nombreuse et variée que ses concurrents, permettant à chacun d’y avoir son quart d’heure de gloire. Twitter élimine tout cloisonnement, allant encore plus loin que Facebook: tout le monde peut y interagir avec tout le monde à l’unique condition de posséder un profil. Si cette absence de cloison explique le succès de Twitter, elle est aussi ce qui permet d’y lire les pires abominations.
Un large spectre d’utilisateurs
Il est bon de dresser une petite cartographie non exhaustive des types d’utilisateurs afin de mieux comprendre le fonctionnement du réseau. Cette tâche, particulièrement ardue du fait du grand nombre d’utilisateurs, peut être abordée sous la forme d’un spectre délimité par deux extrêmes, qui contiendrait tous les types de profils.
Le premier de ces extrêmes, c’est le compte « vérifié », privilège des personnalités dont le profil est authentifié par la plateforme elle-même, assurant que la personne derrière le compte est bel et bien celle qu’elle prétend être. Ces comptes sont l’apanage des artistes, politiciens, influences ou journalistes, et reçoivent un macaron bleu, sorte de tampon d’approbation délivré par le réseau. Le compte vérifié type a une communication bien huilée, parfois même assurée par des spécialistes ; il ne dérape que très rarement, ou bien lors de dérapages « contrôlés » lui assurant de la viralité, du buzz, comme par exemple le compte de Donald Trump connu pour ses déclarations outrancières.
L’autre extrême du spectre, c’est le compte du parfait anonyme. Celui-ci est souvent caché derrière un pseudonyme : on n’en connait rien en dehors de ce qu’il consent à publier. Ces comptes servent parfois à troller : attaquer systématiquement les autres sans se préoccuper de l’absurdité de leurs déclarations, quitte à sombrer dans le harcèlement. Ce sont ces comptes qui publient les messages les plus radicaux et haineux que l’on trouve sur le réseau, souvent entrainés dans le sillage de personnalités « vérifiées » aux revendications idéologiques mieux définies et plus conventionnelles.
Dans cette mesure, le cas de Mme Gave est intéressant : aspirant à des responsabilités politiques pour la première fois, son compte Twitter doit être lissé, aseptisé, afin de coller à la ligne du parti et d’éviter que des gens ne puissent fouiner dans ses vieux tweets, chose qui arrive fréquemment en politique. Son profil était plus proche du deuxième extrême, et l’on a tout fait pour la faire s’approcher du premier. On notera toutefois qu’elle ne se cachait pas derrière un pseudonyme, et que c’est ironiquement cela qui a occasionné sa chute. Comme beaucoup d’autres personnalités dont les déclarations passées viennent compromettre le futur, Mme Gave proteste avec véhémence face à ce qu’elle perçoit comme une injustice : « c’était il y a longtemps », « je ne réalisais pas la portée de mes mots », « ce n’était pas raciste » et autres « je ne voulais pas offenser des gens » reviennent systématiquement. Chacun jugera du bien-fondé de ces arguments.
Le droit d’accès à ces déclarations impulsives semble justifié, tout du moins en ce qui concerne nos politiciens. Il permet de nuancer un discours officiel trop bien calculé, et d’en connaitre un peu plus sur les idées de ceux qui aspirent à gouverner en nos noms. Néanmoins, on ne peut refuser aux gens le droit de changer – bien que dans le cas de Mme Gave, son énième changement de discours après qu’elle ait été évincée semble conforter ses détracteurs.
Tweets, retweets et mentions : des outils de mesure subtils et absurdes
Les tweets, saillies de quelques centaines de caractères, cristallisent l’humain dans toutes ses spécificités. On y rencontre un fin humour, des preuves d’optimisme mais également nos pires travers, la haine la plus gratuite et dégueulasse, celle qui n’est pas constructive, qui fait mal, et que l’auteur, souvent anonyme, ne prend aucun risque en diffusant.
Twitter a érigé comme mètre-étalon le nombre de réactions au détriment d’un examen intellectuel et d’un réel débat. Pour le meilleur comme pour le pire.
Trois moyens existent pour qu’un « tweet x » se diffuse sur le réseau : le Retweet (« RT ») consistant à rediffuser tel-quel « x », le « like », sorte d’approbation donnée à « x », et la « mention », consistant à répondre à l’utilisateur à l’origine de « x ».
Ainsi, un tweet donné ne peut être analysé que conjointement aux réactions des autres utilisateurs, alternance de bons mots et de traits d’esprits plus douteux. Les réactions sont elles-mêmes hiérarchisées par l’algorithme du réseau en fonction des réactions qu’elles reçoivent par la suite, faisant de Twitter un puits sans fond, une agrégation de réactions successives. Dans cette course au buzz, les comptes populaires partent avec un avantage : forts de leur large base de suiveurs, leurs tweets sont bien plus largement diffusés. Néanmoins, un anonyme maitrisant bien les codes du réseau pourra également connaitre la popularité et accéder petit à petit au gotha des twittos en se constituant sa propre base de suiveurs. Si cette effervescence fait de Twitter le réseau social le plus intéressant à suivre, en 2019, elle est également source de ses pires travers.
Fulgurances, effet de groupe et emballement font souvent un cocktail délétère.
Derrière l’écran, la personnalité change, l’individu est protégé au point d’écrire des choses qu’il n’aurait jamais dites en public alors qu’il est sur la plus grande agora de l’histoire. Les déclarations sont ensuite archivées et stockées aussi longtemps que les serveurs du réseau seront en service. Même un nettoyage préventif ne saura éliminer les risques de voir nos déclarations exhumées. Un tweet peut connaitre une infinité de destins : de gazouillis tombé immédiatement dans l’oubli à détonateur de réactions. Notre petit cerveau parait en tout cas incapable de bien saisir le phénomène. C’est ainsi qu’un tweet impulsif peut revenir vous hanter des années plus tard.